Ovide Benoist

QUI fut Ovide Benoist, mobile de 1870 ?
Il appartient à une famille beauceronne aux origines attestées depuis 1726. Laboureurs de père en fils, les Benoist se partagent entre diverses communes d’Eure-etLoir et de Seine-et-Oise, aux limites départementales.
Ovide est le troisième fils de Jules Adolphe Benoist, né à Réclainville(1) en 1817, époux de Mélanie Berland et établi à Gâs(2) sous la Monarchie de Juillet, dans une exploitation affermée d’une centaine d’hectares. Les deux frères aînés, Omer et Oscar, figurent dans le récit d’Ovide, Orphée, le dernier, étant trop jeune pour combattre. Ces prénoms sont dus à un père féru d’Antiquité, et le mérite de « pousser aux études » les quatre fils, tous élèves au collège de Chartres, à un oncle instituteur. Sans doute inspire-t-il aux fils comme au père les opinions républicaines d’Ovide, opposé au service sous Napoléon III mais volontaire sous la République.
La campagne dans la Mobile, pénible et inutile, ne borne heureusement pas l’avenir des frères Benoist. Ovide et ses deux aînés figurent dans une gigantesque généalogie comprenant quasiment toute la Beauce, en épousant trois sœurs Maudemain, de Digny(3). Toutes les branches issues des trois ménages connaissent la notoriété, particulièrement dans les milieux agricoles. Les fils obtiennent leurs diplômes d’État et dirigent exploitations ou entreprises, les filles donnent des enfants dont certains créent une maison de sélection de semences de réputation internationale, animent vie politique et organisations professionnelles. Ainsi, Ovide Benoist succède à son père comme maire de sa commune, il devient conseiller d’arrondissement et cet agriculteur de progrès se voit décerner la Légion d’Honneur. En juillet 1886, il participe avec son frère Orphée à la création du Syndicat agricole de l’arrondissement de Chartres, l’un des premiers en France, en devient administrateur et fonde le Crédit agricole. Propriétaire de sa ferme depuis 1913, Ovide la transmet à son fils Jules Marcel Octave, époux de Marguerite Égasse, fille d’un autre grand syndicaliste agricole, qui devient à son tour maire de Gâs et conseiller général. Ovide meurt honoré de tous et fidèle à ses convictions. L’exploitation est encore, et pour la cinquième génération, propriété de la famille Benoist.
Paul MOLLÉ
SOUVENIR DE LA MOBILE (1870-1871)
APRÈS 26 ans de souvenir, je m’en vais essayer d’écrire le récit de la campagne de la garde mobile d’Eure-et-Loir, en 1870-71, à laquelle ont pris part les trois frères Benoist. Forcément, leur vie à cette époque fut celle de tous leurs camarades de la compagnie, à qui j’adresse en même temps le meilleur souvenir de fraternelle amitié. C’est à mes petits-enfants et arrière-neveux que je dédie ces pages, sans avoir la prétention d’écrire l’histoire au point de vue militaire, ce sera plutôt l’histoire de la vie des camps à cette époque. J’espère graver dans leurs cœurs les sentiments qui m’inspirent aujourd’hui en écrivant ce récit avec les enseignements qu’il comporte. Je regrette de n’avoir apporté à cette campagne aucun carnet rappelant exactement toutes les journées passées, toutes les dates de certains faits qui nous ont cependant frappé. Ce n’est que par le souvenir que je vais essayer de rappeler toutes les espérances, comme toutes les douleurs, par lesquelles nous avons passé(4).
Gas le 2 février 1897, Ovide Benoist
Institution de la garde nationale mobile
 En 1868, l’Empire aux abois, constatant la marche progressive de l’opposition républicaine à son gouvernement conquis par le crime du 2 décembre 1851(5), et qui n’espérait plus soutenir la monarchie menacée que par le résultat d’heureuses campagnes militaires (après l’insuccès de la campagne mexicaine), jugea que les armes ne lui seraient pas toujours favorables et qu’avec l’armée du septennat, dont la plus grande partie des conscrits de chaque année ne contribuaient qu’à remplir la caisse impériale par le rachat de 2 500 F(6) au lieu de maintenir l’effectif de l’armée française, fit voter par la chambre des députés toute à son service grâce à la pression sur les électeurs de la candidature officielle une loi établissant la garde nationale mobile. Tous les Français seraient soldats sédentaires pendant huit années, et susceptibles d’être appelés en périodes d’exercices ou de campagne par simple décret ministériel. Cette garde mobile serait composée de tous les jeunes gens ayant obtenu un bon numéro au tirage au sort ou exonérés par le rachat, ou dispensés comme fils de veuves, aînés d’orphelins et autres cas. Mais ce n’est qu’à la suite de la déclaration de guerre contre le roi de Prusse en juillet 1870 qu’elle fut convoquée pour la première fois. Et encore, ce n’est qu’après les premiers revers, le 20 août, que nous fûmes appelés à la rejoindre à Chartres.
En 1868, l’Empire aux abois, constatant la marche progressive de l’opposition républicaine à son gouvernement conquis par le crime du 2 décembre 1851(5), et qui n’espérait plus soutenir la monarchie menacée que par le résultat d’heureuses campagnes militaires (après l’insuccès de la campagne mexicaine), jugea que les armes ne lui seraient pas toujours favorables et qu’avec l’armée du septennat, dont la plus grande partie des conscrits de chaque année ne contribuaient qu’à remplir la caisse impériale par le rachat de 2 500 F(6) au lieu de maintenir l’effectif de l’armée française, fit voter par la chambre des députés toute à son service grâce à la pression sur les électeurs de la candidature officielle une loi établissant la garde nationale mobile. Tous les Français seraient soldats sédentaires pendant huit années, et susceptibles d’être appelés en périodes d’exercices ou de campagne par simple décret ministériel. Cette garde mobile serait composée de tous les jeunes gens ayant obtenu un bon numéro au tirage au sort ou exonérés par le rachat, ou dispensés comme fils de veuves, aînés d’orphelins et autres cas. Mais ce n’est qu’à la suite de la déclaration de guerre contre le roi de Prusse en juillet 1870 qu’elle fut convoquée pour la première fois. Et encore, ce n’est qu’après les premiers revers, le 20 août, que nous fûmes appelés à la rejoindre à Chartres.
La formation des régiments et de l’encadrement
Depuis quelques mois déjà nous savions que la Préfecture avait offert des places d’officiers dans la garde mobile à plusieurs de nos anciens camarades de collège. L’empire despotique tenait avant tout à s’assurer le concours des serviteurs de son régime monarchique, et il pensait avec justesse que la fortune aidait au tempérament réactionnaire. Aussi, les heureux possesseurs de la terre et de l’argent furent les premiers choisis pour commander aux prolétaires. De science militaire comme de courage, il n’était pas utile d’en posséder et le gouvernement d’alors dorait le képi des nouveaux chefs proportionnellement à la dorure de leur blason ! Le châtelain était nommé capitaine, le riche fermier était sous-lieutenant, le maître artisan intelligent ne pouvait être au plus que sergent. Ces choisis de la faveur avaient été appelés quelques jours seulement avant nous, et c’est après quatre jours d’exercice, qu’ils devaient nous apprendre à manœuvrer !
Le département d’Eure-et-Loir devait former un régiment comprenant autant que possible les mobiles d’un arrondissement pour chaque bataillon, d’un canton pour former une compagnie. Les cantons comme les arrondissements les plus populeux devaient fournir à la compagnie et au bataillon voisin les hommes nécessaires pour les égaliser. Ce mode d’incorporation devait faire l’agrément des soldats, heureux de se sentir les coudes, vivant côte à côte avec leurs camarades de naissance, mais avait certainement un grand inconvénient au point de vue de la discipline. Le simple soldat tutoyait son sous-officier et même assez souvent ses officiers, s’ils s’étaient toujours connus et avaient vécu en intimité avant la guerre. D’un autre côté, le cœur patriotique devait y gagner, chacun tenait à l’honneur de son drapeau, au succès de sa compagnie, la solidarité était plus grande. Le canton de Maintenon auquel nous appartenons, quoique de l’arrondissement de Chartres, est adjoint au 3e bataillon (arr. de Dreux) et forme la première compagnie ; c’est au petit séminaire de Saint-Cheron que va se former notre bataillon. Nous y trouvons, pour notre compagnie Desjardins comme capitaine, un homme dont nous ne connaissons pas la provenance. Tout nous indique qu’il devait faire partie avant la guerre de la police secrète de l’Empire, avec son visage de fouine et ses yeux faux.
 Nous sentons bien que nous avons le malheur d’avoir un capitaine indigne, comme nous le prouvera du reste sa conduite si lâche et fourbe. En revanche, Oury en est le lieutenant, un brave garçon que nous aimons depuis longtemps, et Albert Lelong, fils de fermier, notre excellent camarade, comme sous-lieutenant qui, pendant toute la campagne, tiendra bravement et sera l’un des rares officiers dont nous avons toujours admiré la conduite. Jalon, Blanchard et Péteil, de Gallardon(7), avec Labbé, de Maintenon, sont sergents et Mauduit, d’Épernon, sergent-major. Notre compagnie comprend environ 120 hommes divisés en huit escouades. Nous faisons partie de la seconde, avec Javault comme caporal. Le premier bataillon est composé des autres cantons de l’arrondissement de Chartres ; le deuxième de l’arrondissement de Châteaudun, et le troisième, de celui de Nogent-le-Rotrou. Pendant quelques jours, nous ne sommes réunis à Saint-Cheron que pour l’appel, et pour recevoir notre pièce de un franc pour vivre à notre compte en ville. Aussi ce n’est pas le temps qui nous manque, et, libres dans le séminaire, plusieurs fouillent les pupitres des séminaristes déguerpis, où ils trouvent à leur grande surprise, mêlés aux cantiques et devoirs religieux, des copies abandonnées de chansons légères et d’obscénités, qui nous font tous croire que ces recrues jésuitiques se réservent pour l’avenir, de donner un coup de canif au vœu de chasteté.
Nous sentons bien que nous avons le malheur d’avoir un capitaine indigne, comme nous le prouvera du reste sa conduite si lâche et fourbe. En revanche, Oury en est le lieutenant, un brave garçon que nous aimons depuis longtemps, et Albert Lelong, fils de fermier, notre excellent camarade, comme sous-lieutenant qui, pendant toute la campagne, tiendra bravement et sera l’un des rares officiers dont nous avons toujours admiré la conduite. Jalon, Blanchard et Péteil, de Gallardon(7), avec Labbé, de Maintenon, sont sergents et Mauduit, d’Épernon, sergent-major. Notre compagnie comprend environ 120 hommes divisés en huit escouades. Nous faisons partie de la seconde, avec Javault comme caporal. Le premier bataillon est composé des autres cantons de l’arrondissement de Chartres ; le deuxième de l’arrondissement de Châteaudun, et le troisième, de celui de Nogent-le-Rotrou. Pendant quelques jours, nous ne sommes réunis à Saint-Cheron que pour l’appel, et pour recevoir notre pièce de un franc pour vivre à notre compte en ville. Aussi ce n’est pas le temps qui nous manque, et, libres dans le séminaire, plusieurs fouillent les pupitres des séminaristes déguerpis, où ils trouvent à leur grande surprise, mêlés aux cantiques et devoirs religieux, des copies abandonnées de chansons légères et d’obscénités, qui nous font tous croire que ces recrues jésuitiques se réservent pour l’avenir, de donner un coup de canif au vœu de chasteté.
La révision
Un ordre nous apprend bientôt que la révision sera passée pour ceux qui croiront devoir réclamer contre leur incorporation. Nous sommes encore sous l’Empire, faut-il le servir avec la France investie ? Tel n’est pas notre avis à tous les trois : je puis être réformé comme myope. Que la monarchie succombe, et après, nous servirons tous notre pays ! C’est avec facilité que j’obtiens mon renvoi et je retourne seconder mon père, bien seul à la tête de son exploitation. Mais ce ne sera pas pour longue durée. Et alors Omer et Oscar restent seuls à Chartres et commencent à faire l’exercice : « Portez armes, présentez armes, chargez » et c’est à peu près tout. De défaites en défaites, Sedan fut le terme du régime impérial. L’empereur se rendait à l’ennemi avec son armée, espérant encore que le conquérant pourrait maintenir sa monarchie !
La République est proclamée le lendemain 4 septembre. Je décide avec mon père que je vais retourner partager avec mes frères les périls de la résistance républicaine. Orphée, qui n’a que 14 ans et voudrait bien me suivre, restera seul comme consolation de nos parents ; il leur servira de bâton de vieillesse si le malheur veut que nous succombions pendant la campagne. Avec une bonne paire de lunettes, je ferai le coup de feu comme les autres, et c’est le 15 septembre que je viens demander à Chartres mon engagement pour faire partie de la 1ère compagnie du 3e bataillon et être incorporé au côté de mes frères. Mais la mobile de Chartres est partie de la veille pour Alençon. La préfecture, qui presque seule dirige, paraît abandonner la défense du département.
Le père Casimir, capitaine de recrutement à qui je me recommande comme cousin de Mademoiselle Guerrier, déjà sa fiancée avant la guerre, me promet de m’emmener le lendemain avec lui la rejoindre à Alençon par le chemin de fer. Nous passons par le Mans, notre train est bondé de soldats qui rejoignent de toutes les directions. Nous sommes enthousiasmés des sentiments patriotiques des habitants sur tout notre parcours. À chaque arrêt aux stations, de bonnes citoyennes ont envahi les gares pour nous offrir par les portières des verres de cidre, des raisins. Nous les remercions en criant : « Vive la France ! » Elles nous répondent : « Vive l’Armée ! » Je me trouve en arrivant avec le père Jousse, juge de paix d’Auneau, qui quoique âgé de plus de cinquante ans s’engage aussi dans la mobile comme simple soldat ; il vient retrouver son fils, mobile du premier bataillon.
Nous sommes à nouveau réunis tous les trois et devrons combattre côte à côte pendant la campagne. Mes frères me racontent ce qu’ils ont vu ou fait depuis que je les ai quittés. Ils m’apprennent que le gouvernement ayant demandé des volontaires de la mobile pour les troupes algériennes pendant la guerre, une petite partie des soldats de la compagnie se sont engagés. Ils disaient que c’était pour voir du pays ! Mais leurs camarades ont pensé que c’était pour ne pas voir les Prussiens. Ils me disent aussi qu’ils ont déjà marqué leur velléité républicaine, la veille à Alençon, en forçant avec des camarades les commerçants de la ville à enlever l’effigie impériale sur les médailles en plâtre jointes à leurs enseignes. Nous sommes heureux maintenant d’être réunis. Je suis facilement équipé : une vareuse grise avec croissant en liseré rouge sur les manches, un pantalon de drap gris avec raie rouge, mais de si mauvaise qualité que nous pensons que le drap en avait été fabriqué pour les hôtes des prisons. Un fusil à tabatière, commode mais trop lourd, une musette comme havresac(8).
Retour à Chartres
Il n’y avait pas quatre jours que nous étions à Alençon, que l’ordre nous apprend que nous devions retourner à Chartres. La ville a décidé de se défendre et rappelle ses enfants. C’est par étape, cette fois que nous ferons la route, et nous obtenons de partir en avant-garde ; on sera mieux reçu chez l’habitant qui sera moins envahi pour nous recevoir. La première étape est longue, d’Alençon à Mortagne(9), 40 km avec une musette garnie de linge et de cartouches, et nos lourds fusils, nous la trouvons dure à parcourir ! Ce n’est qu’en changeant d’épaule coupée par la bretelle que nous faisons cette première marche à laquelle tant d’autres succèderont. Nous logeons chez les habitants et nous sommes bien accueillis. Que le repos semble bon ! Le lendemain nous n’avons qu’à nous rendre à Rémalard(10), ce n’est pas très long, puis de Rémalard à Condé-sur-Huisne et Bretoncelles(11), nous sommes déjà habitués à la marche. Notre meilleur passage sera à Pontgouin(12) où nous arrivons vers midi, heureux de trouver sur la place du pays Monsieur Minard, un grand ami de notre père.
Il nous emmène déjeuner chez son beau-père Monsieur Bataille, maire de Pontgouin où se trouve déjà son frère Armand Minard, avec deux autres francs-tireurs de Paris arrivés depuis quelques jours, qui nous donnent des nouvelles de Tell Minard, de Montlouet(13) notre voisin et ami engagé avec eux dans les francs-tireurs de Paris. Armand nous dit qu’il ne l’abandonna, blessé près de Sedan la veille de la capitulation, qu’après avoir réussi à le remettre entre les mains des Belges, en le portant sur son dos plus d’un kilomètre pour passer la frontière. Sa blessure, une balle dans le bras effleurant à la suite la poitrine, sera longue à guérir mais nous aurons le bonheur de le revoir. Heures de délices que nous avons passées ! Monsieur Bataille garde sa table pour de simples soldats et notre capitaine va manger à l’auberge !
Nous sommes maintenant près de chez nous, les clochers de Chartres pointent à l’horizon et nous y arrivons de grand cœur. Notre logement est encore assuré chez M. Papillon, comme avant notre départ pour Alençon, dans cette bonne maison où l’on nous accueillait si bien. Édouard Papillon, qui n’a que 14 ans et aimait déjà tant les soldats, est plein de prévenances pour nous. Le bon déjeuner du matin ne suffit pas, il bonde nos poches de cigares, peut-être sentait-il déjà qu’il aurait plus tard une vie si mouvementée, que tout jeune encore il mourrait en aventure, assassiné par les sauvages du cœur de l’Afrique. […].
À Maintenon
Nous sommes donc forcés de rester à Maintenon et de tâcher de le garder, ce que nous ferons pendant quelque temps. Notre compagnie est chargée pour la nuit de la défense de la gare. Et pour la première fois nous couchons sur la dure. Je me rappelle avoir passé la nuit sur les tablettes à bagages, que c’était dur grand Dieu, impossible de dormir, cela vous rompt les os !
Les jours suivants, notre service est de monter des grand’gardes, par section ou compagnies. Les unes sont envoyées au bois de Fourches(14), les autres sur la lisière des bois. C’est le lendemain qu’en grand’garde à la Croix-à-la-Poule(15) nous voyons revenir un mobile sur la route de Paris. C’est notre ami Charles Égasse, sergent au 2e bataillon, qui revient de Droué chercher son équipement qu’il avait été obligé d’abandonner au combat de la veille sur les Marmousets(16). Cerné par l’ennemi, il n’avait pu se sauver qu’en cachant chez une vieille femme son fusil et ses effets militaires, et en s’habillant en civil ! Il est bien heureux d’avoir pu retrouver son équipement après le départ des Prussiens et nous raconte les phases du combat. Peu après, c’est le corbillard qui rapporte le corps du brave commandant Lecomte qui passe sur la route. Nous nous découvrons au passage et présentons les armes sans commandement. Notre capitaine Desjardins seul regarde de côté, ne voulant pas honorer le courage de ce héros !
À Maintenon commence la vraie campagne. Nous avons reçu des couvertures blanches, vertes et de toutes les couleurs pour ceux qui n’en avaient pas reçu, et nous bivouaquons dans les bois. Nous n’avons pas encore reçu de toiles de tentes, mais nous faisons des abris avec des branchages. Nous faisons la popote par escouades. J’ai oublié de dire que notre deuxième escouade était composée de Javault, caporal ; Colas, clairon, de Pont-sous-Gallardon(17) ; Plé, de Hanches ; Capitreau et Hamard, de Saint-Piat ; Bréjean, d’Esclimont(18) ; Piédole et Moulin, d’Épernon et de nous trois. Nous vivrons toujours ensemble, en bon accord et solidaires, nous aurons presque toujours assez d’argent pour acheter la nourriture qui nous manquera. Dans quelques jours nous recevrons des havresacs, des toiles de tentes, des bassines et des bidons. Chacun portera sa part du mobilier général qui nous suivra toute la campagne. À Maintenon, nous sommes dans notre pays. Tous les soirs, nous dînons chez Moulin, ce n’est pas encore le moment des privations.
La troupe augmente tous les jours, il arrive des francs-tireurs de la Sarthe, de Cognac et d’autres compagnies. Les marins aussi, plusieurs compagnies que nous sommes heureux de voir à nos côtés, leur réputation valeureuse les a précédés et nous ne doutons pas, à leur air décidé et à tout ce qu’ils racontent, qu’ils mangeront tous les Prussiens qui leur feront face. Nous avons une demi-batterie d’artillerie, trois pièces, et nous croyons que ce n’est pas rien ! C’est aussi à Maintenon que Chevrier, d’Épernon, vient s’engager dans notre compagnie, il ne veut plus rester à Epernon. Il y avait trois ou quatre jours que nous étions à Maintenon, qu’une occasion se présente pour nous d’aller à Gas.
Le commandant de Foudras, d’un corps de francs-tireurs, demande des guides pour le conduire en excursion dans les environs, du côté de Gas, où il peut y avoir quelques Prussiens. Monsieur Corbière, maire de Maintenon, auxiliaire précieux de la défense à ce moment, nous présente et nous acceptons de grand cœur. Nous arrivons à Gas avec la petite troupe pour y retrouver notre père aussi ému que nous. Il nous raconte le passage des Prussiens le lendemain du combat d’Épernon, les vexations qu’il a dû subir et les difficultés qu’il a éprouvées pour satisfaire à leurs réquisitions. Orphée ne nous quittera pas d’une semelle pendant le temps que nous allons rester, mais nous ne pouvons voir notre mère partie en émigration dans le Perche avec tous les bestiaux de la ferme, comme le firent la plupart des fermiers des environs, sur la recommandation du gouvernement de la Défense qui pensait par là pouvoir affamer l’armée ennemie d’occupation. Après avoir pris possession du village et avoir placé des sentinelles sur les hauteurs pour le garder d’une surprise, les officiers ne tiennent plus qu’à se faire héberger. Mon père les invite à dîner. Mais le commandant de Foudras, un marquis, veut avant tout rendre visite à Monsieur le curé. Nous sentons les secrets désirs qui animent ce légitimiste qui ne manquera pas de revenir, pensant trouver la table mieux garnie chez Monsieur le maire. Mon père ayant dit que les Prussiens sont souvent à Épernon, un jeune franc-tireur sous-officier et se disant ancien Garibaldien, s’offre pour y faire une reconnaissance, ce qui est accepté par les officiers. Il s’habille avec nos anciens effets et part à pied dans cette direction, pour revenir deux heures après sans avoir rien vu. Le soir nous sommes obligés de rentrer à Maintenon avec les francs-tireurs, heureux d’avoir passé quelques bonnes heures chez nous. Cette compagnie de francs-tireurs était composée de toutes sortes de gens et le commandant de Foudras ne leur plaisait pas. Aussi, près du petit bois Brocheton, une balle vient siffler auprès de la tête du commandant et de la mienne, qui était à côté, sans qu’on ait entendu de coup de feu. Je crois, le marquis aussi, que l’un de ses francs-tireurs aura cherché à l’atteindre, muni d’une cartouche chargée de matière explosive silencieuse.
La cour martiale
Le Gouvernement de la Défense nationale avait institué depuis quelques jours la cour martiale, sorte de conseil de guerre encore plus terrible pour fortifier la discipline des troupes.
 Tout militaire, comme tout civil, reconnu coupable par ce tribunal, était fusillé dans les 24 heures. Aussi, depuis cette institution, le commandement ne cherchait-il que l’occasion de faire un exemple, il lui fallait quand même trouver des victimes. Un artilleur avait menacé son lieutenant de se venger d’une punition qu’il avait dû subir et il avait été rapporté qu’aux environs un mendiant qui s’était trouvé dans la campagne, questionné et certainement menacé par une bande de Prussiens qui lui demandaient où ils trouveraient des cigares, avait répondu qu’il y avait un bureau de tabac à Armenonville. Il fut pris et traduit devant la cour martiale avec l’artilleur. Jugement rendu par avance, victimes exigées pour terrifier la troupe comme les populations occupées, ils furent condamnés à mort ! Pour nous qui connaissions Barbri(19) depuis longtemps, pour le voir à la ferme venir offrir des balais et mendier son pain, qui savions qu’il était idiot au plus haut point et ne devait pas être considéré comme responsable de ses actes, il nous fut pénible de voir qu’au nom de la défense de la patrie, on commettait un assassinat ! L’intérêt de la défense n’autorisait pas cette injustice. Ce malheureux artilleur, tout jeune encore, ne mourrait pas au champ d’honneur, tué par des balles ennemies ! Dès le lendemain matin, toutes les troupes furent appelées à assister à l’exécution qui eut lieu dans une marnière, derrière l’ancien camp de César, près de la ferme de la Folie. Nous fûmes rangés devant l’endroit choisi ou deux piquets s’élevèrent.
Tout militaire, comme tout civil, reconnu coupable par ce tribunal, était fusillé dans les 24 heures. Aussi, depuis cette institution, le commandement ne cherchait-il que l’occasion de faire un exemple, il lui fallait quand même trouver des victimes. Un artilleur avait menacé son lieutenant de se venger d’une punition qu’il avait dû subir et il avait été rapporté qu’aux environs un mendiant qui s’était trouvé dans la campagne, questionné et certainement menacé par une bande de Prussiens qui lui demandaient où ils trouveraient des cigares, avait répondu qu’il y avait un bureau de tabac à Armenonville. Il fut pris et traduit devant la cour martiale avec l’artilleur. Jugement rendu par avance, victimes exigées pour terrifier la troupe comme les populations occupées, ils furent condamnés à mort ! Pour nous qui connaissions Barbri(19) depuis longtemps, pour le voir à la ferme venir offrir des balais et mendier son pain, qui savions qu’il était idiot au plus haut point et ne devait pas être considéré comme responsable de ses actes, il nous fut pénible de voir qu’au nom de la défense de la patrie, on commettait un assassinat ! L’intérêt de la défense n’autorisait pas cette injustice. Ce malheureux artilleur, tout jeune encore, ne mourrait pas au champ d’honneur, tué par des balles ennemies ! Dès le lendemain matin, toutes les troupes furent appelées à assister à l’exécution qui eut lieu dans une marnière, derrière l’ancien camp de César, près de la ferme de la Folie. Nous fûmes rangés devant l’endroit choisi ou deux piquets s’élevèrent.
Deux pelotons se tiennent à dix pas, chargés de foudroyer les malheureux au commandement. Bientôt le fourgon qui amène les condamnés arrive, suivi d’une charrette qui porte les deux cercueils. On descend les condamnés, une toile noire est rabattue sur leurs figures, leurs mains sont liées derrière le dos ; leurs jambes ne peuvent les porter mais on les soutient debout pendant la lecture de la sentence qui les condamne. Nous les entendons pleurer de désespoir ! L’effet produit sur les troupes massées est terrifiant ! Les chefs, surtout les plus mauvais, en sont radieux, le commandant de Foudras surtout, fume un gros cigare, fier de son importance ! Les condamnés sont attachés à chacun des poteaux et tout à l’heure, le lieutenant qui commande l’exécution abaissera son sabre, signal de la décharge générale qui transpercera les deux malheureux. Nous baissons la tête et les 24 coups retentissent ensemble. Les deux victimes sont à demi maintenues par les liens à leurs poteaux troués et un sergent, Léon Lefèvre, de la compagnie d’Auneau, lui si tendre et si bon, doit encore leur donner le coup de grâce, règlement bien inutile mais qu’il exécute, forcé par la consigne, en détournant la tête pour ne pas voir l’horreur qu’on lui fait commettre ! Toutes les troupes maintenant défilent devant les suppliciés et nous rentrons à Maintenon le cœur navré et épouvantés. […].
© Société Archéologique d’Eure-et-Loir (SAEL), NS 99, 2009-1.
[anchor id= »notes »]Notes[/anchor]
1 Canton de Voves, arr. de Chartres.
2 Canton de Maintenon, arr. de Chartres.
3 Canton de Senonches, arr. de Dreux.
4 Ndle. Imprimés en 1898 à la demande de l’auteur, pour sa famille et ses proches (sans dépôt légal), par l’Imprimerie Industrielle et Commerciale, à Chartres, ces mémoires sont publiés ici avec l’autorisation des détenteurs actuels de cette plaquette. La SAEL remercie M. François Benoist, petit-fils d’Ovide, son épouse et leurs enfants, de lui avoir confié le journal de leur aïeul et de lui permettre de le publier. Typographie, orthographe et présentation actualisées ; quelques coupures. Notes de Paul Mollé.
5 Coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte. Le narrateur traduit ses sentiments républicains.
6 « L’armée du septennat » (loi de 1832) imposait un service de 7 ans aux conscrits ayant tiré un « mauvais numéro » (quota cantonal du nombre total de conscrits, calculé proportionnellement à la population mais variable selon les besoins). En janvier 1868, la durée du service fut ramenée à 5 ans et on créa une garde mobile composée des exonérés du service ayant tiré un bon numéro, jusque-là dispensés mais désormais appelés en temps de guerre. En 1870, seuls les cadres avaient été désignés parmi les notables, comme le dit le narrateur. L’administration impériale avait fixé pour le rachat un tarif forfaitaire utilisé pour payer la prime d’engagement des volontaires.
7 Canton de Maintenon, arr. de Chartres.
8 Le mauvais équipement causa de grandes souffrances à ces unités lors de l’hiver 1870.
9 Mortagne-au-Perche, Orne.
10 Orne, chef-lieu de canton, arr. de Mortagne-au-Perche.
11 Orne, canton de Remalard, arr. de Mortagne-au-Perche.
12 Canton de Courville, arr. de Chartres.
13 Hameau de Gallardon.
14 Lieu dit, commune de Hanches, canton de Maintenon, arr. de Chartres.
15 Commune de Saint-Martin-de-Nigelles, canton de Maintenon, arr. de Chartres.
16 Lieu dit, commune d’Épernon, théâtre du combat du 4 octobre.
17 Hameau de Bailleau-Armenonville, canton de Maintenon, arr. de Chartres.
18 Canton de Maintenon, arr. de Chartres.
19 Voir Provost, abbé, La garde mobile d’Eure-et-Loir et ses aumôniers, Chartres, 1901. L’état civil de Maintenon n’enregistre qu’anonymement leur décès, sans en mentionner la cause.
Monument aux morts de la guerre de 1870-1871, Chartres, et détail : « Le Mobile blessé » (© J. Clément).



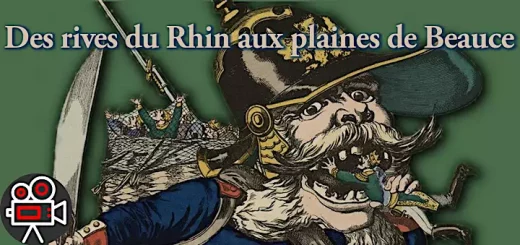

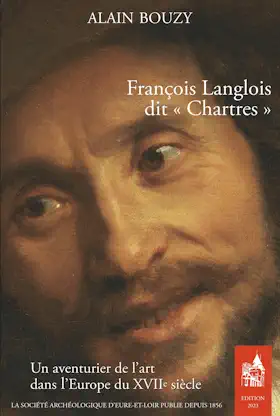



Les commentaires récents